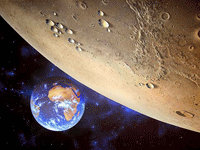Il y a 71 ans, le terrible exode des populations françaises et belges s’achevait
grâce à l’armistice signé. A supposer que les Allemands aient été abreuvés
pendant six ans de propagande haineuse, de nombreux excès auraient été
enregistrés un peu partout sur les routes de France.
Mais c’est le contraire qui advint.
Si l’on excepte quelques regrettables incidents comme il en survient toujours,
la tenue correcte de l’Occupant fut immédiatement remarquée.
« Vous ne pouvez pas savoir comme j’avais peur de ces gens-là, raconta peu
après une femme qui fuyait avec un groupe paniqué, groupe qui fut rattrapé
à Montargis par les Allemands. C’est le diable en personne que je voyais arriver.
Je me suis faite toute petite ; j’ai serré contre moi ma petite Colette qui pleurait : “Oh ! Maman ! Qu’est-ce qu’ils vont me faire ?”
Les Allemands étaient à bicyclette. Ils chantaient.
Nous, les militaires, les civils,on s’est tous arrêtés, on a tous levé les bras !
Eux ont crié :
“
Camarades, camarades. Armistice signé.” »
(
La Gerbe, 18 juillet 1940, p. 1).
Cas isolé ? Nullement. Lisez le reportage de Jean de la Hire intitulé :
Le Crime des Évacuations. Les horreurs que nous avons vues (éd. Tallandier, 1940), lisez
L’Exode : sur les routes de l’an 40 de Nicole Ollier (éd. Robert Laffont, 1969).
Lisez
La guerre du mensonge de Paul Allard (Les Éditions de France, 1940)…
Tous confirment le témoignage de cette femme.
J’irai même plus en loin en soulignant que, s’ils avaient voulu se venger,
les Allemands n’auraient même pas eu besoin de commettre des excès.
Ils n’auraient eu qu’à laisser les autorités belges et françaises s’occuper
des huit millions de réfugiés qui, victimes du «
bourrage de crâne »,
avaient fui l’avance allemande dans le plus complet désordre, croyant
qu’un nouvel Attila se précipitait sur eux.
Une Française, Odette de Puigaudeau, qui se trouvait sur les routes de l’exode,
se souvient :
«
Par milliers arrivaient en longues files silencieuses des vieillards à bout de forces, des malades, des bébés pleurant un biberon, des enfants qui n’avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Ils voulaient rentrer chez eux. Pas de trains, ni de camions. Autour des gares, ils s’affalaient, le désespoir aux yeux, sur leurs misérables bagages […]. Les Œuvres ? A peu près désertes. Les cantines, les gîtes possibles ?
Fermés pour la plupart. Les administrations ? Désorganisées. Trop d’hôpitaux
à l’abandon. Quelques personnes, de cœur et de tête, des assistantes sociales,
une poignée de dames de la Croix-Rouge, qui avaient tenu bon au vent de panique, des auxiliaires s’efforçaient de parer au plus pressé.
La marée de misère montait chaque jour »
(
La Gerbe, 23 janvier 1941, p. 6).

(
NSV-Schwester mit Kindern, 1943)
S’ils avaient dû attendre le secours des autorités françaises,beaucoup seraient
morts de faim, de fatigue, de maladie et du manque de soins.
Ils durent la vie à la
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (
NSV),
c’est-à-dire à l’Organisation nationale-socialiste pour le Bien public qui
«
march[a] littéralement sur les talons de l’armée, dispensant ses collaborateurs, jetant hâtivement les bases de son organisation »
(
Les Hommes au Travail, 8 octobre 1942, p. 10).
O. Puigaudeau poursuit :
«
Soudain, on annonça un train routier, un long train de camions pleins de vivres, d’abris démontables, de matériel, de médicaments : ils portaient un nom difficile
à dire : “Hilfzug Bayern”. Fallait-il donc qu’en France, le secours nous vint d’un pays en guerre, d’un pays ennemi, et de si loin ? On vit s’arrêter sur les places publiques des cuisines roulantes ; des hommes et des jeunes femmes en uniformes bruns,
avec la tache rouge et noire de la croix gammée au bras, qui remplissaient
des gamelles et distribuaient des boîtes de lait. On raconta qu’en province,
on construisait des baraquements pour les réfugiés du Nord.
Des trains et des camions de rapatriement commençaient à partir.
La NSV s’était mise au travail »
(
La Gerbe, 23 janvier 1941, p. 6).
Le «
Hilfzug Bayern » (Train de secours bavarois) était arrivé à Dunkerque :
«
il y distribua quotidiennement des repas chauds et froids à 15 000 personnes.
Avec ses 142 voitures motorisées et ses 5 wagons, il pérégrina alors à travers
le Nord de la France. La partie motorisée s’attarda surtout à Lille et à Reims
et y distribua 100 000 repas par jour, tandis que la partie stationnaire se fixait
à Pantin et y servait au total 200 000 repas chauds et froids par jour.
Les repas étaient servis par des hommes de la NSV, les femmes enceintes,
les jeunes mamans et les familles nombreuses étant privilégiées.
Pendant plusieurs semaines, 22 infirmières allemandes, 28 assistantes sociales allemandes et des infirmières françaises travaillèrent inlassablement dans un centre d’accueil où il y avait en permanence 4 000 à 6 000 réfugiés.
Chaque centre de la NSV avait sa cuisine propre, une infirmerie, une laverie,
une pièce où étaient soignés les bébés, un dortoir, etc.
Dans la mesure du possible, la Croix-Rouge française mit des langes à la disposition de la NSV » (
Les Hommes au Travail, déjà cité).
La NSV récupérait les vivres qui avaient été abandonnés en France
dans la fuite éperdue. C’est ainsi qu’au Havre:

«
la NSV mit la main sur les plus grandes réserves de vivres et en dépit
des destructions faites dans le port. Elle parvint à sauver 1 500 demi-bœufs
et 500 moutons, 7 000 caisses de pommes, 25 000 caisses de conserves de fruits
et légumes, 10 000 caisses de conserves de viande, 1 500 sacs de riz, de fèves,
de pois, 2 000 quintaux de farine, etc. Grâce à ces vivres furent soignés 40 000 habitants du Havre, ainsi que ceux de Rouen, Fécamp, Yvetot, Amiens,
Compiègne, Beauvais et Beaumont » (
Id.).
Les membres de la NSV «
découvrirent des réfugiés dans des écoles, dans
une caserne abandonnée, même dans les caves glaciales d’une ancienne usine
d’eaux minérales... Des centres d’accueil furent hâtivement équipés,
des petites cliniques furent ouvertes. Les médecins français faits prisonniers
furent libérés et attachés à ces cliniques.
Les "sœurs brunes et bleues" de la NSV (les infirmières)
s’occupèrent spécialement des mamans et des enfants.
Combien de femmes n’avaient pas accouché le long de la route démunies
des soins les plus élémentaires ? Combien même n’en étaient pas mortes ?
Un jour un flot de réfugiés arrivés à Abbeville ne comptait pas moins de 300 nourrissons et enfants de moins de 2 ans. Deux infirmières aidées de 2 assistantes sociales allemandes parvinrent à les débarbouiller en un après-midi » (
Id.).
L’ampleur de l’activité de la NSV peut se résumer en quelques chiffres :
« En 3 mois, elle distribua 27 millions de repas froids et 15 millions de repas
chauds sans compter ceux distribués par la Wehrmacht, la Croix-Rouge allemande
et le Hilfzug Bayern. Elle distribua aux mamans et aux enfants plus de 3 millions
de pains et 8,5 millions de rations de lait ; 103 000 malades furent soignés,
700 enfants furent mis au monde et 2,6 millions de réfugiés furent hébergés
de nuit dans les locaux des la NSV » (
Id.).
A l’époque, certains se demandèrent si l’action de la NSV n’avait pas été réalisée
dans un but de propagande. Soucieuse de se faire une opinion,
O. Puigaudeau raconte qu’elle a benoîtement demandé à l’officier qui commandait
le camp de réfugiés pourquoi l’Allemagne était venue au secours des civils belges
et des français :
«
Il m’a regardé avec étonnement. “Pourquoi ? Mais… par humanité” »
(
La Gerbe, 23 janvier 1941, p. 1).
C’était si évident qu’à Nuremberg, l’Accusation française, pourtant si prompte
à déceler dans tous les actes des Allemands les intentions les plus mauvaises,
ne put que jeter un voile pudique sur l’action de la NSV en mai-juillet 1940.
La semaine dernière, j’ai parlé d’une politique de réconciliation franco-allemande
qui exista sous l’Occupation. En voici d’autres exemples.
En octobre 1942, dans une sorte de lettre ouverte, une étudiante allemande
invita très poliment la jeunesse française à multiplier les contacts avec la jeunesse germanique. On lisait :
«
Déjà souvent on a fait l’essai de mettre en contact, par correspondance,
les jeunes de France et ceux d’Allemagne. Le tempérament allemand, plutôt sérieux et pondéré, aimerait entrer en relations avec les jeunes, vivants et ardents,
du pays de France ensoleillé.
Nous autres, les jeunes d’Allemagne, aimons, chez les jeunes français,
le sang ardent ; nous aimons la mélodieuse langue française ; les riches
contrées françaises nous incitent à faire des voyages pour visiter les belles villes françaises,le beau Midi lumineux de notre voisin de l’Ouest.
Moi, ainsi que beaucoup de nos jeunes filles et jeunes gens, désirons cordialement
une amitié étroite entre l’Allemagne et la France et les jeunesses allemande
et française, afin de faciliter un échange de pensées et d’idées, ce qui servirait
à la compréhension réciproque. [Signé] Hilde Schulte-Terboven »
(
Le Lien, 18 mars 1943).
En janvier 1944, un écrivain allemand, Walter Gross, parla ainsi de la France :
«
Je ne connais aucun pays d’Europe, sauf la France, qui pourrait offrir ce
qu’on nomme un “paysage idéal” dans le sens de la perfection naturelle réalisée
par elle-même et en dehors de l’homme.
De tous les pays, la France est le plus humain. »
Après avoir souligné qu’en France, et surtout en Lorraine, les maisons des villages étaient moins bien agencées qu’en Allemagne, il s’empressait d’ajouter :
«
Mais comme nous sommes pleins de bonne volonté pour chercher à comprendre
ce qui nous étonne de prime abord, nous arrivons aussi à nous rendre compte
que cette simplicité sommaire est voulue peut-être par un instinct de la conscience, toute commodité nouvelle devant être payée par un surcroît de dépendance.
Et parce que rien n’est plus cher au Français que son indépendance personnelle,
nous comprenons qu’il préfère sans doute une vie qui peut paraître moins
confortable aux yeux de l’étranger, mais qu’il estime plus humaine pour lui-même »
(
Le Lien, n° 16, janvier 1944, p. 3).
Quelques semaines après, dans une allocution publique, le capitaine Sauerlaender, chef de la Propaganda-Staffel de Dijon, traita de la nécessité de
«
donner une nouvelle orientation à l’avenir de l’Europe » et de
«
développer de nouvelles formes de coexistence ».
Loin de parler d’une hégémonie allemande, il précisa :
«
Certes, ce postulat n’exige pas l’effacement de la personnalité de chaque peuple, telle qu’elle s’est développée au cours de l’histoire… Il s’agit plutôt de modérer
les prétentions individuelles dans ce qu’elles ont d’excessif et d’outrancier
dans leur caractère dogmatique. Le plus grand obstacle à l’union européenne
serait celui d’une intelligence française étroitement enfermée dans un égocentrisme qui ne reconnaîtrait d’autre valeur que la sienne, ce qui équivaudrait pratiquement
à refuser le contact avec les valeurs allemandes. La France est-elle prête à abandonner cette attitude qui l’a déterminée pour une part à entrer dans la guerre ? La réponse à cette question décidera des futurs rapports franco-allemands.
En s’ajustant à la dialectique de cette nouvelle Europe sans abandonner
ses propres valeurs culturelles, elle trouvera sa raison d’être sous la forme
d’une entité parmi d’autres entités nationales telles qu’elles ont été conçues
par le sang et par l’histoire » (
Le Lien, n° 18, mars 1944, p. 4).
Le capitaine énuméra ensuite les principaux partisans français de l’entente,
puis il lança :
«
Si les idées nouvelles et si les hommes nouveaux succombaient en France, l’absence de ce pays dans la communauté européenne pèserait lourdement
sur l’édification et sur l’organisation pacifique du continent.
Si les éléments nouveaux l’emportent au contraire, entraînant avec eux
l’assentiment du peuple français, la France pourra fournir à la Révolution
européenne les plus puissants élans. Le démon de la Jeunesse et le fantôme
de la vieillesse se disputent l’âme de la France. Puisse la Bergère de Domremy,
qui fut l’âme jeune autour de laquelle la France s’est jadis retrouvée, venir encore
une fois au secours de la Jeunesse » (
Id.).
Des mots…, me dira-t-on. En guise de réponse, je me contenterai de citer un seul exemple, totalement occulté aujourd’hui : l’affaire du sérum antidiphtérique.
La France en possédait un stock très convenable.
A partir de l’été 1943, l’Allemagne, qui connaissait déjà de graves problèmes
de production dus au blocus et aux bombardements, voulut en réquisitionner notamment pour les besoins urgents de l’armée.
Le 12 mai 1945, le directeur de l’Institut Pasteur écrivit que, le temps passant,
les occupants «
étaient devenus plus pressants, puis menaçants »
(
Hoover Institute, La vie de la France sous l’Occupation, 1940-1944,
éd. Plon, 1957, tome 2, p. 894, déclaration de Jacques Tréfouel, membre
de
l’Académie de Médecine et Directeur de l’Institut Pasteur).
On les comprend, car ils menaient une lutte à la vie et à la mort…
Quoi qu’il en soit, les autorités françaises refusèrent. Que firent les Allemands ? Investirent-ils l’Institut Pasteur pour se servir, comme ils auraient été en droit
de le faire ― je rappelle que selon les principes de la morale, en cas de nécessité grave, les biens privés deviennent communs, et doivent être donnés à ceux qui
en ont un besoin urgent ? Non. Ils négocièrent et… se firent berner.
«
Sur les mille litres de sérum antidiphtérique à mille unités par centimètre cube
qu’ils exigeaient, il leur en a été fourni dix » (
Ibid., p. 895).
Mieux encore (si l’on peut dire). Les Français parvinrent à convaincre les Allemands aux abois de ne prélever aucun sérum destiné à la population française.
En contre-partie, la France acceptait de produire le précieux produit si l’Occupant fournissait «
des chevaux devant être utilisés pour eux ».
Un accord fut conclu et deux cents bêtes furent livrées. Mais, là encore,
les Allemands se firent berner. Les Français laissèrent volontairement courir
aux chevaux «
tous les risques de l’immunisation », si bien qu’en 1945,
«
sur les deux cents chevaux fournis, une vingtaine seulement survivaient »,
qui avaient «
fourni une quantité minimum de sérum » (
Id.).
Des exemples de ce genre, je pourrais en fournir des dizaines, qui démontrent
que l’occupant ne fut pas celui que l’on prétend…
Nous sommes bien loin de l’image du « nazi » détestant la France et souhaitant l’écraser pour prendre sa revanche sur 1918.
Cette guerre, il ne fallait pas la perdre.
Mais elle a été perdue et nous en payons aujourd’hui le prix fort. L’Europe se meurt.
Vincent Reynouard.Source :
RIVAROL n° 3008 du 15 juillet 2011,page 11.